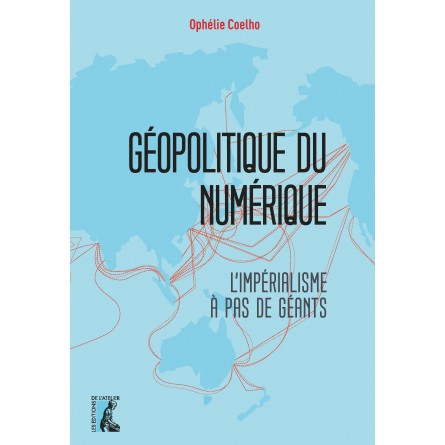
Il y a quelques dizaines d’années d’années, en cours de géographie à Lyon, le géographe Michel Foucher rappelait à ses étudiants (dont j’étais) que les frontières étaient la marque réelle, symbolique et imaginaire des discontinuités géopolitiques. L’analyse géographique des situations socio-politiques qu’elles incarnaient, montrait qu’elles étaient à la fois des barrières et des interfaces. Le numérique aussi est à la fois une barrière et une interface, explique la développeuse et chercheuse indépendante Ophélie Coelho (@opheliecoelho) dans son livre, Géopolitique du numérique (Les éditions de l’Atelier, 2023), avec la difficulté qu’il y a, sur ce sujet, de distinguer le côté poreux du côté étanche du numérique. Le numérique tient-il plus d’une barrière, d’une possible nouvelle frontière dans la mondialisation ou au contraire, est-elle l’interface, le liant d’une nouvelle géopolitique dont les frontières se recomposeraient en dehors de toute géographie ?
Pour Ophélie Coelho le numérique est une couche supplémentaire de puissance et de rivalités, entre Etats, mais aussi entre Etats et multinationales. Loin d’être un outil de dématérialisation, quand on le regarde sous l’angle géopolitique, c’est bien sa grande matérialité qui frappe, son développement territorial et les oppositions puissamment politiques qu’il entérine et renforce. Le numérique est l’outil d’affrontement des différents blocs du monde contemporain, le cœur du technopouvoir, cette nouvelle puissance qui nous dépossède tous.
Le numérique est au coeur de la domination
Cette puissance de la technique est au fondement de l’expansion économique américaine d’après-guerre, qui impose à l’Europe de devenir le terrain d’expérimentation des programmes informatiques de ses entreprises, explique la chercheuse en revenant sur l’histoire de l’expansion d’IBM notamment, puis de Microsoft et Intel. Avec la technologie, “le monde occidental est marqué par une redistribution de plus en plus prégnante des pouvoirs entre autorités publiques et acteurs privés”. On passe du paradigme de la Big Science gérée par l’Etat (à l’image du programme de la bombe nucléaire et son projet Manhattan ou de la conquête spatiale via la Nasa) à celle de la Big Tech, c’est-à-dire d’entreprises inondées de financements publics pour produire leurs propres programmes de développement (comme le raconte pour Wired l’historienne Margaret O’Mara dans son livre, The Code, sur l’histoire de la Silicon Valley, montrant que la Valley ne s’est pas faite toute seule à grand coup de capital-risque et d’entrepreneuriat – comme le prétend le livre de Sebastian Mallaby -, mais que son succès est surtout l’affaire d’une injonction phénoménale d’argent public, de programmes sociaux et d’allégements fiscaux). Dans cette nouvelle configuration, les Etats perdent la main sur la définition des objectifs et la programmation des projets : la gouvernance et la stratégie restent privées. On passe d’un modèle technologiste expansionniste dirigé par les Etats, à une gestion décentralisée assurée par des fournisseurs privés (comme le raconte très bien Ben Tarnoff dans son livre, Internet for the people) qui donne naissance à des multinationales puissantes, d’abord dans les réseaux et hardware, avant de s’étendre aux services logiciels. Cette expansion est favorisée à la fois par des politiques d’investissements à faible taux d’intérêts et par la commande publique (de la CIA, de la Darpa, puis des grandes administrations d’États…) qui permettent d’orienter encore un peu les projets, mais de moins en moins. Les Etats et administrations deviennent peu à peu un client comme les autres. Reste que ce sont bien les investissements publics qui permettent aux grandes entreprises de la tech de le devenir, comme l’a montré dans ses livres (notamment l’État entrepreneurial) l’économiste Mariana Mazzucato… Via ces contrats, les Big Tech s’accaparent l’intelligence économique et les données et mettent en dépendance les administrations publiques en assurant leurs socles techniques. Face à la montée de la puissance des Big Tech, les Etats vont tenter de limiter leurs monopoles, mais sans vraiment y parvenir, notamment parce que les règles à l’encontre des monopoles ont été largement affaiblies. Au contraire, en délégant les grands projets de systèmes d’information aux acteurs du numérique et du conseil, on a fermé les yeux sur les risques liés à la concentration de ces acteurs dont la puissance est devenue largement transnationale et sur la perte de puissance même des Etats (comme le racontent, avec l’essor des cabinets de conseil en France, Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre dans leur livre, Les infiltrés). Les entreprises de la tech et du conseil sont devenues quasi monopolistiques : elles disposent des données, des logiciels, des services, des produits… tant et si bien que les Etats (comme nombre d’autres acteurs, toutes les entreprises, mais également les individus…) reposent pour leurs fonctionnements numériques sur des architectures de produits sur lesquelles ils n’ont aucune maîtrise. Leur régulation est devenue d’autant plus difficile que le numérique est désormais le cœur d’une domination technique globale. La surpuissance que ces acteurs ont atteint font que tout développement de solutions techniques équivalentes devient inaccessible, comme l’explique James Bessen en parlant de capitalisme superstar. Qui peut faire un cloud aussi puissant qu’Amazon, Microsoft ou Google ? Qui demain pourra faire de l’IA aussi puissante que les acteurs qui sont en train de prendre cette course de vitesse avec des niveaux d’investissements en passe de devenir irrattrapables ?
Des Big Tech façonnées par les blocs géopolitiques
Coelho revient également sur la réorganisation des chaînes logistiques mondiales, avec l’introduction de la robotisation et de la production à flux tendu, mais plus encore de l’informatique et de l’information pour piloter l’industrie d’un bout à l’autre de la chaîne (non sans rappeler les travaux de Miriam Posner). “Le lean érige notamment l’informatique comme élément clé des stratégies de modernisation de l’industrie, en encourageant une compatibilité totale entre les systèmes d’information internes et externes à l’entreprise”. L’infrastructure numérique (pas seulement physique, mais bien également logicielle) crée une relation de dépendance à ceux qui la produisent. L’enjeu géopolitique du numérique consiste alors à devenir maître de ces systèmes auxquels tous les autres sont soumis. Face aux concurrences nationales ou internationales, face aux nouveaux entrants parfois particulièrement agiles, les grands acteurs vont opter pour une politique systématique qui consiste à copier ou racheter les développements novateurs, à améliorer ou enterrer les produits concurrents. De Netscape enterré par Internet Explorer à YouTube acheté par Google, en passant par WhatsApp accaparé par Facebook… la liste des acquisitions des géants du numérique pour assurer leur domination progresse au rythme de l’évolution de leur capitalisation boursière. Non seulement ils capturent les technologies, mais également les données, les fournisseurs et bien sûr les utilisateurs, à l’image des places de marché d’Amazon, de Rakuten ou d’Ali Express. Cette hégémonie n’est pas d’ailleurs sans poser problème, puisqu’elle permet à ces plateformes de tordre la concurrence, de réguler le marché à leur profit via les algorithmes de recommandation dont ils sont juges et partis, et via un système de rente pour tous ceux qui souhaitent accéder à ces marchés à l’image des magasins d’applications et de leur système de commission, ou pire encore avec les applications à tout faire chinoises WeChat et Alipay (les “super apps”). Ophélie Coelho revient plusieurs fois d’ailleurs sur le contre-modèle chinois. Qui n’est pas tant un contre-modèle d’ailleurs qu’une réponse politique à la dépendance aux technologies américaines. Pour imposer son modèle, la Chine a recours aux mêmes modalités que les Etats-Unis : à savoir des financements publics continus. Auquel elle ajoute un protectionnisme exacerbé via le contrôle pour limiter l’investissement étranger et surtout la disponibilité des ressources matérielles qui vont lui permettre de venir concurrencer les firmes américaines dans le domaine technologique. Ce qui est marquant, dans cette géopolitique, c’est que malgré leurs puissances, les multinationales restent façonnées par les blocs dont elles sont issues et dont leurs marchés dépendent. Si les protocoles parcourent la planète, leurs modalités concrètes, elles, qui s’incarnent dans les multinationales, restent très influencées par les oppositions géopolitiques, qu’elles n’arrivent pas à totalement dépasser.
Capture technique et prolétarisation
Protocoles de paiements, mécanismes d’identification unique, systèmes logiciels et écosystèmes de services… Les interfaces et protocoles logiciels se répandent partout, organisent et structurent l’information et les échanges, les systèmes de production dans tous les secteurs. Coelho fait un détour par son parcours personnel pour nous rappeler combien le web a transformé le mode de distribution des produits numériques et a fait évoluer leur modèle économique. Elle rappelle que les grandes entreprises du numérique ont été moteur dans ces transformations, en œuvrant à la promotion de leurs produits, souvent par la gratuité et surtout en cajolant particulièrement les développeurs pour qu’ils adoptent leurs produits et en fassent la promotion autour d’eux. AWS d’Amazon, à l’origine de son service cloud, vise à optimiser le travail des développeurs internes avant d’être ouverts à d’autres entreprises, selon un modèle de capture du client, qui se rend vite compte qu’il ne peut pas faire aussi bien pour le même prix. Le déploiement de services infrastructurels devient “difficilement remplaçables une fois intégrés”. Comme avec Google ou Microsoft, l’enjeu est de rendre captif à un écosystème qui impose ses normes, tarifs et conditions et qui peut facilement les faire évoluer à son gré, comme Tim Hwang le montrait pour la publicité programmatique. La dépendance aux acteurs monopolistiques ne cesse de se renforcer.
Coelho insiste sur cette politique qui a été à l’œuvre consistant à “capturer les usages professionnels et les connaissances techniques”. Peu à peu, ces acteurs ont favorisé les savoirs relatifs à leurs plateformes et appauvrit les savoirs relatifs à la gestion des machines. Désormais les développeurs sont spécialisés dans les langages de Microsoft ou d’Amazon plus que dans les langages natifs, selon un phénomène de prolétarisation assez classique, visant à priver les sujets de leurs savoirs. De plus en plus, les utilisateurs sont formés aux produits, pas à comprendre. Nous devenons des consommateurs d’interfaces, renforçant la puissance du technopouvoir.
Des acteurs publics dépossédés de leurs capacités d’agir
Dans cet affrontement bilatéral entre la Chine et les Etats-Unis, l’Europe (et la France) sont restés des PME. Malgré un beau réseau d’acteurs et de compétences, nos projets de souveraineté numérique sont restés de petite taille quand ils n’ont pas été plantés, à l’image du moteur Quaero. “Aucune vision à long terme n’émerge des tentatives multiples de formaliser une stratégie industrielle et technologique”. Quand en 2011 le projet de cloud national Andromède sort des cartons, les acteurs retenus (Thalès, Orange et Dassault) n’ont pas vraiment d’expertise en la matière, contrairement à quelques acteurs plus petits, comme Gandi, Nexedi ou OVH. Pour Coelho, nous n’avons cessé, en France, de favoriser de grandes entreprises au détriment de la cohérence, de l’ambition ou de la vision. Les cabinets de conseil font la promotion des produits dominants avec qui ils sont partenaires pour développer leurs solutions logicielles, au détriment de solutions alternatives qui pourraient bénéficier de la commande publique pour autant qu’elle parvienne à organiser et financer les acteurs nationaux ou européens. Mais cela suppose de miser sur un effort de fond et de long terme, quand les échecs des grands projets informatiques français ou européens n’aident plus vraiment à sortir de la dépendance aux solutions américaines.
L’acteur public peu à peu perd ainsi de son pouvoir. Le droit ne l’aide pas vraiment, analyse finement Ophélie Coelho : la protection des données et la règle du consentement placent la responsabilité entre les mains de l’usager, qui doit juger et gérer les risques potentiels des services qu’il utilise sans en avoir les clefs. Plutôt que de contrôler lui-même l’usage effectif des données, le régulateur confie aux usagers ce soin, sans leur donner beaucoup de pouvoir pour cela. L’utilisateur, pourtant, n’accède qu’à l’interface, sans savoir même comment fonctionne le produit qu’il utilise. D’où le fait que le DSA et le DMA européens proposent de recourir à l’audit pour lever ces écueils… Mais face à des produits fermés et monopolistiques, en grande majorité hébergés aux Etats-Unis, ce droit d’audit sera certainement difficile à faire valoir, sans compter qu’il faudra disposer des capacités techniques nécessaires… L’audit risque de rester un vœu pieu.
La technologie est devenue un instrument de pouvoir qui “échappe à la fois à l’utilisateur et à la compréhension des instances de contrôles”. D’où le fait que le législateur ait tendance à sur-contrôler les usages des individus plus que la conception des équipements, d’autant plus difficile à contrôler que ceux-ci sont en perpétuelle évolution. Enfin, l’autre levier juridique disponible, à savoir la lutte contre les monopoles, s’est lui aussi révélé défaillant (d’ailleurs, l’IA Act ne prévoit rien contre le développement monopolistique de l’IA et ne ce soucie pas vraiment du pouvoir des acteurs de l’IA). Défaillant, d’abord et avant tout parce que ces monopoles sont insaisissables. Ils sont bien plus le fait de logiciels interconnectés que d’un acteur unique et omnipotent. Coelho invite à trouver une autre voie afin d’exercer un meilleur contrôle sur les flux d’information plutôt que les données…
Le numérique : le risque d’une privatisation du pouvoir
Ophélie Coelho consacre toute une partie à la “territorialisation des infrastructures”, c’est-à-dire aux infrastructures bien réelles de l’immatériel : centre de données, câbles sous-marins, champs d’éoliennes marines pour produire l’électricité nécessaire aux fonctionnements des serveurs… Comme Fanny Lopez, elle constate surtout la privatisation des infrastructures. Quelques acteurs (les Gafam surtout) ont pris possession des câbles, des satellites, des centres de stockage… Eux, assurent leur souveraineté et maîtrisent la chaîne d’infrastructure dont leur activité dépend ! Là encore, explique-t-elle, le développement très concentré des centres de données bénéficie surtout d’une fiscalité très avantageuse… Reste que ces multinationales de la tech entrent en concurrence directe avec les citoyens sur l’exploitation des ressources territoriales. Les tensions sur l’approvisionnement électrique ou hydrique se renforcent. Alors que les Etats, eux, ont toujours mesuré leurs actions à leur impact local, les multinationales, elles, entrent en concurrence frontale avec les territoires qu’elles exploitent. Dans cette géopolitique technologique, plusieurs niveaux apparaissent : d’un côté les territoires qui produisent et gèrent les systèmes à l’échelle planétaire, de l’autre ceux qui exploitent les données et les infrastructures, à des échelles hyperlocales. D’un côté le numérique renforce et polarise la géopolitique globale des grands blocs politiques, de l’autre, elle redistribue et exacerbe les tensions à un niveau hyperlocal.
Pour Coelho, le numérique certes concentre et polarise les pouvoirs, mais également développe une “interdépendance mondiale”. La technologie produit une mutation géopolitique inédite, notamment en produisant des acteurs privés aussi forts que des Etats, dont on peine à prendre la mesure des conséquences sociales que cela implique, notamment l’impact sur la démocratie, les droits de l’homme, la vie privée, l’éducation, la santé ou l’emploi… Du fait de leur grande granularité et de leur grande maîtrise par les multinationales monopolistiques, les produits numériques sont très souples. Ils permettent d’imposer des conditions d’utilisation spécifiques et de couper les accès au cas par cas et de favoriser des connivences de l’autre. Dans ces produits extrêmement modulables, les clients ne sont pas en contrôle, ce sont les fournisseurs de technologie qui restent maîtres. Les Big Tech ont construit un pouvoir très fort et très fin à la fois. La technologie produit de fortes et puissantes dépendances dont il est difficile de s’extraire. Ophélie Coelho conclut son livre en proposant de mesurer la perte de souveraineté à l’aune de la criticité des services dont on dépend. Pour elle la souveraineté ne dépend pas tant d’une grande politique stratégique de création de champions que d’une action plus pragmatique consistant à utiliser la commande publique pour soutenir un maillage d’entreprises moyennes afin qu’elles se renforcent les unes les autres. Construire son indépendance technologique, sa souveraineté numérique, prend du temps et nécessite de mobiliser des investissements et des capacités techniques sur le long terme. C’est là où nous avons été trop longtemps défaillants. Enfin, elle invite à garder le contrôle sur les infrastructures critiques, par exemple en favorisant une copropriété publique-privée.
La grande question de cette géopolitique, c’est surtout la montée d’un pouvoir privé qui vient renforcer plus que perturber les équilibres géopolitiques en cours. Un pouvoir face auquel nous ne parvenons pas vraiment à mettre de limite, à l’image des niveaux de capitalisation boursière de ces entreprises, atteignant des montants qui leur assure une pérennité que bien des Etats n’auront peut-être jamais. Le sous-titre du livre est “l’Impérialisme à pas de géants”, et il me semble, très justement, que nous sommes confrontés à une puissance impériale inédite, qui, à partir d’un certain niveau, est capable de se développer sans n’avoir plus de compte à rendre. Une géopolitique capable de s’affranchir de toute considération géographique comme politique, pour s’imposer par sa seule puissance à produire le monde moderne.
Ophélie Coelho dresse ici une belle histoire du déploiement de l’industrie informatique, documentée et précise. Son livre, à la fois pédagogique et toujours complexe, permet de mieux comprendre l’évolution des rapports de force économiques que le numérique redessine.
Hubert Guillaud
A propos du livre d’Ophélie Coelho, Géopolitique du numérique : l’impérialisme à pas de géants, Les éditions de l’atelier, 2023, 272 pages, 21 euros. Lire aussi son ITW pour Maisouvaleweb.fr.
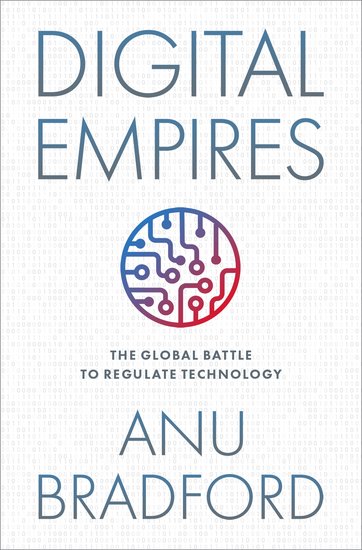
Signalons que la professeure de droit, Anu Bradford (@anubradford), vient de publier un livre sur la compétition géopolitique visant à établir des modèles de gouvernance numérique entre les Etats-Unis, la Chine et l’Europe : Digital Empires, The global battle to regulate technology. Dans une excellente interview pour Tech Policy Press, elle explique que le modèle réglementaire américain est axé sur le marché, le modèle chinois sur l’Etat et le modèle européen sur les droits. Elle rappelle que si les entreprises des Big Tech sont devenues de tels empires, c’est parce que le gouvernement américain a fait le choix politique de ne pas leur imposer de garde-fous. Pour elle, l’Europe construit une troisième voie, dont la faiblesse est certainement de ne pas reposer sur des acteurs technologiques aussi puissants qu’on les trouve dans le bloc chinois ou américain, notamment parce que nous n’avons pas un marché linguistique, culturel et politique unique et encore moins de marchés de capitaux uniques, comme le proposent la Chine ou la Silicon Valley. Pour elle enfin, le modèle chinois montre à nombre de nations qu’il n’est pas nécessaire d’être libre pour innover. Ce qui renforce l’enjeu de proposer et trouver un modèle techno-démocratique qui fasse la différence, et qui ne soit pas techo-nationaliste ou techno-protectionniste. Et pour l’instant, les Etats-Unis et l’Union européenne ont du mal à montrer qu’il existe une manière libérale et démocratique de gouverner l’économie numérique. La course à la puissance technologique risque de nous laisser sans troisième voie, entre la techno autoritaire et la techno ultra-libérale, c’est-à-dire entre des empires aussi puissants l’un que l’autre où les individus n’ont plus la parole ni l’espace pour exister. La complexité de la régulation européenne donne du pouvoir aux plus grandes entreprises et ne les contraint que par des amendes qu’elles peuvent s’offrir pour aller sur ce marché. Le risque, souligne Anu Bradford, serait que la régulation européenne échoue dans son projet, qu’elle ne parvienne pas à articuler suffisamment la défense du droit face à la technologie pour montrer que la démocratie libérale a eu une chance d’exister dans l’impérialisme technologique. C’est peut-être bien là le problème. Pris dans l’étau du colonialisme numérique, nous sommes par définition sans pouvoir. Et c’est bien cette concentration qui rend toute troisième voie impossible… alors que tous les acteurs politiques ne cherchent qu’une chose, assurer la concentration et la domination de quelques acteurs de leurs blocs. Alors que c’est bien cette logique monopolisitique qui rend le numérique délétère.
2 thoughts on “De l’impérialisme numérique”