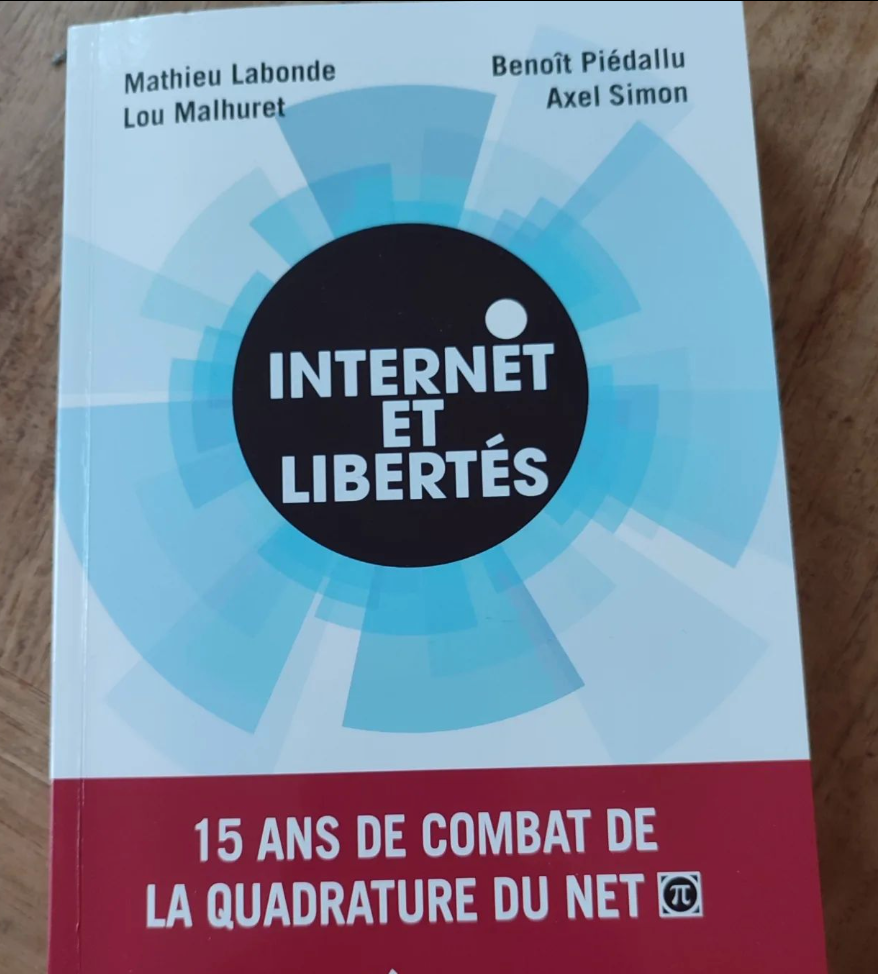Le petit livre des économistes Thomas Coutrot et Coralie Perez, Redonner du sens au travail est un ouvrage bienvenu en ces temps où tout le monde parle assez mal du travail. En s’intéressant à l’importance que ceux qui travaillent donnent au sens de leur travail, ils permettent de mieux comprendre ce qui dysfonctionne. Pour les deux chercheurs, l’appauvrissement du sens au travail explique pour beaucoup les difficultés actuelles de notre rapport au travail. Longtemps, nous avons accepté le travail en échange de sa promesse consumériste, c’est-à-dire la promesse qu’il nous permettrait de vivre et consommer comme on le souhaite. Ce n’est plus le cas, quand le pouvoir d’achat de la plupart des salariés stagne voire s’effondre. Le sens du travail lui-même se perd et s’appauvrit, notamment du fait de l’essor du reporting, du management par le chiffre et de la perte d’autonomie que cela induit. Nous sommes confrontés à un travail de plus en plus individualisé et qui, de ce fait, perd son sens collectif. Une dissonance se produit entre “deux conceptions de la qualité : celle, objective, instrumentale et chiffrée du management ; et celle, relationnelle et sensible, des destinataires”, pointant par là la dichotomie entre une activité définie par le management et de l’autre la même qui doit être en permanence négociée avec d’autres destinataires du travail, clients ou usagers. Enfin, ils relèvent une autre dissonance : entre le productivisme (“l’engrenage de la production”) et la crise écologique. Ils distinguent ainsi 3 niveaux du sens au travail : “l’impact du travail sur le monde (l’utilité sociale), sur les normes de la vie en commun (la cohérence éthique) et sur le travailleur lui-même (la capacité de développement)”.

Les métriques qui se sont instillées partout empêchent le “travail vivant” au bénéfice du “travail mort”. Dans les entrepôts de logistiques, sous commande vocale, il n’est plus possible d’édifier une “belle palette”, soigneusement rangée. L’activité des travailleurs est réduite à un pur travail d’exécution qui doit suivre des process, des timing, des instructions sans pouvoir plus en dévier… C’est oublier que le travail ne se réduit jamais aux critères de qualités définis par le management : il faut compter sur l’importance de l’épanouissement, du jugement d’utilité ou de la cohérence éthique…Pour Perez et Coutrot, nous devons reconsidérer le travail à partir d’une conception politique : notre travail transforme le monde, nous transforme nous-même et questionne les normes politiques qui organisent la société en les reproduisant ou en les négociant.
L’essentiel de leur court livre repose sur les enquêtes relatives aux conditions de travail de la Dares qui montrent que les professions peu qualifiées trouvent particulièrement peu de sens à leur travail (ouvriers de l’industrie, employés de commerce, employés de banque et d’assurance). Mais le sens au travail n’est pas l’apanage des professions supérieures non plus : aux tâches fragmentées des uns, répond le fastidieux contrôle du reporting des autres: Les professions du soin, du care, ceux qui travaillent en contact avec le public trouvent souvent plus de sens à leur activité que ceux qui se limitent à des fonctions productives. Par contre, si leur sentiment d’utilité sociale est plus fort, leur rapport aux conflits éthique, lui, est dégradé. Dans ces métiers, le fait de ne pas pouvoir apporter le soin nécessaire du fait des conditions de travail délétères pèse sur le moral. Quant au télétravail, soulignent-ils, il n’apporte pas de solution à la perte de sens, mais au contraire tend à favoriser l’éclosion des conflits éthiques.
Les deux auteurs estiment que la question du sens au travail n’est pas un problème de riche, mais est une question largement négligée des politiques publiques comme des directions des ressources humaines. Les uns comme les autres continuent de faire comme si la seule motivation au travail était le gain monétaire. C’est ce que semblent dire également de plus en plus de Français : pour 45% d’entre eux, le seul intérêt du travail est le salaire (et ils n’étaient que 33% à le penser il y a 30 ans), mais cela traduit certainement bien plus la résignation et la dégradation du rapport au travail à l’heure où tout ce qui le protège est abattu, législation après législation.
Pourtant, rappellent-ils très justement, les travaux de recherche montrent très bien que les allocations n’ont jamais eu l’effet qu’on leur prête : à savoir ne pas prendre un emploi parce qu’on bénéficie d’aides sociales. La plupart des gens reprennent un emploi, même quand ils y perdent sur le plan financier. Si gagner sa vie est important, l’utilité personnelle semble plus importante encore. La grande démission a montré que le sens concernait autant les moins diplômés que les plus diplômés. La valeur travail n’est pas en cause : tout le monde sait ce que le travail apporte (et certainement encore plus ceux qui n’en ont pas). Le problème, c’est qu’on ne cesse d’en réduire le sens, de réduire la part vivante du travail sous sa part morte. Les changements organisationnels en continue, les process, les objectifs chiffrés, le reporting… sont autant de technologies zombies qui produisent un rapport au travail flou, imprévisible, fragmenté, plus axé sur son rapport productiviste que sur sa réalité concrète… très éloigné des salariés. Les deux auteurs reviennent ainsi sur le développement du toyotisme, qui se voulait à l’origine un management par objectif assez favorable à l’autonomie au travail, alors qu’il a surtout produit une traçabilité et un contrôle permanent. Le numérique est ici bien en cause. En permettant de codifier et standardiser les tâches, de les surveiller, de produire des indicateurs… Il a largement participé à créer un travail hors-sol, un néo-taylorisme., qui détruit les marges de manœuvres individuelles comme collectives, à l’image des logiciels de tarification à l’activité du secteur hospitalier et médical. Au final, la dégradation du travail touche tous les secteurs du travail.
Outre le conflit entre les objectifs et le sens, les transformations incessantes du travail, de son organisation (là encore facilitées par le numérique) sont vécues comme épuisantes. Le management par les chiffres produit une intensification et une fragmentation du travail qui favorise le désengagement et la perte de sens. L’organisation du travail et notamment la montée des contraintes qui pèsent sur lui, participe également de la perte de sens. Enfin, les questions écologiques remettent profondément en question les rapports productivistes. Beaucoup de métiers connaissent désormais des “conflits fonctionnels”.
Certes, certaines entreprises tentent de s’attaquer au problème, par exemple en développant des politiques de responsabilités sociales et environnementales (RSE), qui privilégient trop souvent les questions écologiques sur les questions sociales. Mais là encore, la fiabilité des indicateurs mis en place reste bien souvent douteux. Même la finance responsable pose problème, rappellent-ils : le secteur des énergies fossiles est bien plus souvent exclu des portefeuilles d’actions par prudence financière plus que pour des raisons climatiques, du fait de la dévalorisation probable de ces actifs à terme du fait de politiques plus restrictives… Quant aux entreprises à mission et aux formes plus coopératives encore, elles sont bien trop marginales pour représenter un changement. La codétermination ne suffit pas toujours à améliorer la soutenabilité écologique ni à réduire les conflits éthiques. Pour Coutrot et Perez (comme chez Carbonell ou Supiot), il faut aller plus loin dans la socialisation des entreprises : faire que celles-ci soient sous le contrôle des apporteurs de capital, mais également des salariés ainsi que des usagers et clients. Quant aux entreprises libérées, les deux chercheurs dressent le même constat que celui que dressait Danièle Linhart : si elle favorise l’autonomie professionnelle, permettant de choisir comment organiser son travail, bien souvent, elle ne permet pas aux salariés d’accéder à l’autonomie stratégique consistant à définir les finalités du travail, qui restent le profit. Dans ces entreprises, bien souvent, la libération tient surtout d’une intensification du travail là encore. La participation reste asymétrique… La sociocratie est encore bien loin ! Le néo-taylorisme numérique y est comme partout très présent, trop présent.
La perte de sens au travail explique bien souvent la mobilité professionnelle. L’absence de possibilité de développement et d’utilité sociale sont les premières raisons qui poussent à partir, auxquelles il faut ajouter les exigences émotionnelles et le faible soutien hiérarchique. Si la perte de sens peut alimenter des démissions individuelles ou des contestations collectives , les auteurs soulignent encore que la question du sens est restée négligée par les syndicats (pas chez tous visiblement, les auteurs valorisent notamment la démarche revendicative (.pdf) mise en place par la CGT, qui consiste à élaborer une conception commune de la qualité du travail qui renforce la cohésion entre salariés et produit des résultats pour mieux négocier le rapport de force, à l’image de cette expérience dans un centre d’appel).
Il y a 20 ans, les 35 heures, c’est-à-dire la réduction du temps de travail, ont été la dernière conquête syndicale. Sur tous les sujets relatifs au travail, nous sommes depuis plongés dans une régression qui semble sans fin. Partout, la discussion dans le monde du travail est vue comme une perte de temps, à l’image des réunions d’où rien ne sort vraiment que des consignes top-down nouvelles à appliquer. Ce rapport non démocratique, caporaliste au travail est assurément une impasse. Comme disait Supiot, sans justice au travail, c’est le travail lui-même qui n’est plus possible. Et les auteurs de rappeler que “les salarié.es soumis.es à des consignes rigides ou des tâches répétitives sont plus nombreux.ses à s’abstenir aux élections ou à voter pour l’extrême droite”. La perte de sens au travail à des conséquences directes sur la perte de sens de nos sociétés elles-mêmes.
Hubert Guillaud
A propos du livre de Thomas Coutrot et Coralie Perez, Redonner du sens au travail : une aspiration révolutionnaire, Le Seuil, “La République des Idées”, 2022, 160 pages, 13,5 euros.